Listeners:
Top listeners:
-
play_arrow
Radio 2 L’Hers Nr.1 For New Music And All The Hits!
-
 play_arrow
play_arrow
Spring Studio, première salle de pilate du sud toulousain Entreien avec Alexandre Saint Louban de Spring Studio
-
 play_arrow
play_arrow
“Nous dansons sur un volcan” – Gaël Brustier décrypte la décivilisation R2LH
-
 play_arrow
play_arrow
“Nous dansons sur un volcan” – Gaël Brustier décrypte la décivilisation R2LH
- home Accueil
- keyboard_arrow_right Actualité
- keyboard_arrow_right Blog radio2lhers
- keyboard_arrow_right Articles
- keyboard_arrow_rightInterview de Gaël Brustier – « La route vers la décivilisation » (Éditions du Cerf)
Interview de Gaël Brustier – « La route vers la décivilisation » (Éditions du Cerf)

Ecouter et voir l’entretien: https://radio2lhers.fr/nous-dansons-sur-un-volcan-gael-brustier-decrypte-la-decivilisation/
Propos recueillis par Sébastien Claret – Radio2Lhers.fr
Sébastien Claret : Bonjour. Vous êtes politologue et essayiste. Vous avez récemment travaillé aux côtés de Juliette Meadel, qui était encore il y a peu ministre déléguée chargée de la Ville. Vous venez de publier aux éditions du Cerf La route vers la décivilisation.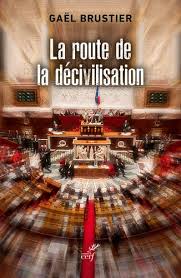 Nous allons revenir ensemble sur ce concept, mais j’aimerais d’abord évoquer votre démarche d’intellectuel. En 2009, nous nous étions rencontrés pour la sortie de votre ouvrage Recherche le peuple désespérément. Vous y analysiez déjà la rupture entre les élites et le peuple, en constatant que la gauche avait perdu le contact avec son électorat traditionnel, passé en partie au Front national. Vous faisiez alors figure d’exception parmi les analystes politiques. Depuis, d’autres travaux ont prolongé cette réflexion, notamment ceux de Jérôme Fourquet (L’archipel français) ou de Christophe Guilluy.
Nous allons revenir ensemble sur ce concept, mais j’aimerais d’abord évoquer votre démarche d’intellectuel. En 2009, nous nous étions rencontrés pour la sortie de votre ouvrage Recherche le peuple désespérément. Vous y analysiez déjà la rupture entre les élites et le peuple, en constatant que la gauche avait perdu le contact avec son électorat traditionnel, passé en partie au Front national. Vous faisiez alors figure d’exception parmi les analystes politiques. Depuis, d’autres travaux ont prolongé cette réflexion, notamment ceux de Jérôme Fourquet (L’archipel français) ou de Christophe Guilluy.
Dans l’introduction de votre nouveau livre, vous évoquez la mission de l’intellectuel, notamment celle de repérer les « signaux faibles ». Que signifie cette expression, et pourquoi ces signaux sont-ils aujourd’hui si souvent niés ou mal interprétés ?
Gaël Brustier : Vous évoquiez Recherche le peuple désespérément, coécrit avec Jean-Philippe Huelin. Nous étions alors militants politiques, étudiants chercheurs — lui en histoire, moi en science politique — et nous observions attentivement notre pays. En politique, on s’en remet trop souvent aux sondages. Or, ceux-ci ne reflètent que des tendances déjà installées.
Les véritables transformations apparaissent dans ces signaux faibles qu’il faut savoir discerner : l’évolution de certains électorats, des comportements sociaux, des visions du monde. Nous avions, par exemple, repéré très tôt la droitisation d’une partie de la gauche. Cela exige curiosité et observation.
Je crois qu’on ne peut pas comprendre la politique sans s’intéresser concrètement au pays, à ses habitants, à leur manière de vivre. C’est une forme d’enquête permanente, nourrie par la curiosité et le contact humain.
S.C. : Pourtant, beaucoup d’intellectuels français, par idéologie ou par confort, refusent de voir ces signaux faibles. Vous, vous revendiquez d’une approche gramscienne, c’est-à-dire d’une analyse détachée de toute grille idéologique préconçue. Est-ce cela qui explique la cécité de certains milieux intellectuels ?
G.B. : Oui, en partie. Beaucoup d’intellectuels ou de responsables politiques ne fréquentent que leur propre milieu et s’en remettent aux journaux pour « comprendre » la société. Or, on ne comprend qu’en allant vers les autres.
J’habite en Seine-Saint-Denis, j’y ai beaucoup circulé, fréquenté tous les milieux. Cette expérience m’a donné, y compris au ministère de la Ville, un regard un peu décentré.
Mais cette curiosité, je l’applique aussi à mon territoire d’origine, le Charolais, ou aux zones industrielles sinistrées. On y observait déjà les socialistes passés à l’extrême droite. Ces évolutions sont d’abord des cheminements humains, intellectuels, moraux, parfois sentimentaux. Il faut écouter comment les gens pensent, réagissent, parlent. C’est cela qui nourrit à la fois le travail politique et la compréhension du social.
S.C. : Est-ce cette absence d’écoute qui explique la déconnexion d’une partie de l’intelligentsia et des médias français ? Delphine Ernotte, la présidente de France Télévision disait : « Nous essayons de représenter la France telle qu’on voudrait qu’elle soit ». C’est révélateur, non ?
G.B. : Cette phrase m’a souvent été répétée par des journalistes eux-mêmes conscients du problème.
Une partie du pays vit déconnectée du réel. Si vous lâchez l’un de ces cadres parisiens en zone industrielle, rurale ou en banlieue, ce serait pour lui une détresse morale tant il ignore ces milieux. Beaucoup ne traversent le périphérique que pour prendre l’avion.
Il ne s’agit pas de mépris, mais de peur et de besoin de se rassurer. On fabrique des consensus artificiels — les Jeux olympiques, par exemple — pour recoller symboliquement le pays. Mais ces « consensus d’en haut » dissimulent une véritable apesanteur sociale.
S.C. : Vous parlez aussi dans votre livre de « prolophobie », cette forme de mépris de classe persistante. Vous prenez l’exemple des émissions de M6 consacrée à la cuisine gastronomique. Dernièrement un journaliste de Télérama a consacré un article à l’émission » La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi. » Le magazine présentait l’émission comme réactionnaire, passéiste et nationaliste…
G.B. : Oui, c’est un symptôme révélateur. Quand on vit en banlieue, on côtoie des gens qui aiment la saucisse au pinard sans se poser de questions. Mais pour certains journalistes de Libération ou de Télérama, c’est presque l’antichambre du fascisme !
Comme le disait René Lévesque : « On ne peut pas prétendre aimer le peuple et détester les goûts du peuple. »
Il existe une dépréciation systématique des goûts populaires, au profit d’un modèle de réussite normé — devenir chef étoilé, par exemple. Or, cette réussite-là n’est pas accessible à tous. Ces codes, ces goûts, ces destinations « obligées » construisent un imaginaire de classe.
S.C. : Parlons du concept central de votre livre : la « décivilisation ». Emmanuel Macron l’a repris dans le débat public, suscitant une polémique. Edwy Plenel y a vu une expression d’extreme droite et a accusé la président de se mettre dans les pas de Renaud Camus. Quelle est votre propre définition ?
G.B. : Ma référence, c’est Norbert Elias, pas Renaud Camus.
Elias expliquait que dans tout processus de civilisation, il existe des moments de décivilisation : des périodes où la société ne parvient plus à contenir la violence, où les pulsions reprennent le dessus.
Il ne s’agit pas d’un concept fasciste, contrairement à ce qu’a pu dire Edwy Plenel. C’est un outil d’analyse sociologique. On observe ces processus aux États-Unis, par exemple, où la brutalisation de la vie politique a précédé l’émergence du trumpisme.
Ce que je décris, c’est la brutalisation de nos démocraties : la perte de civilité, de médiation, d’intériorisation des règles du vivre-ensemble.
S.C. : Vous regrettez également la disparition des espaces de débat entre courants intellectuels différents. Les années 1990 semblaient encore permettre ce dialogue. Aujourd’hui, tout paraît polarisé.
G.B. : Oui. Aujourd’hui, discuter avec quelqu’un, c’est déjà être suspect.
À une époque, je pouvais lire des revues trotskistes, des publications chrétiennes ou Éléments sans être catalogué. C’est fini.
L’anti-intellectualisme domine, y compris dans les partis politiques. Le débat n’existe plus : tout adversaire devient un ennemi à abattre. C’est une brutalisation du champ politique.
Les jeunes générations, de plus, ne cherchent plus à se former intellectuellement ; beaucoup veulent simplement « être connus sur TikTok ». On passe d’une culture du savoir à une culture de la visibilité.
S.C. : Vous évoquez aussi dans votre livre le phénomène « MAGA » aux États-Unis. Vous expliquez que Trump est le produit d’une longue guerre culturelle.
G.B. : Oui. Le mouvement Make America Great Again s’inscrit dans une histoire longue. Pat Buchanan, dès 1992, mobilisait déjà deux millions d’Américains contre la mondialisation.
La crise de 2008 et la désindustrialisation ont propulsé le trumpisme. Derrière Trump, il y a des intellectuels, des conservateurs qui lisent, qui structurent un discours. Ce n’est pas qu’un phénomène populiste ; c’est une bataille culturelle au sens gramscien du terme.
S.C. : Et en France, la gauche a-t-elle conscience qu’elle a perdu cette bataille culturelle ?
G.B. : Non. Depuis le quinquennat Hollande, la gauche a explosé idéologiquement. Elle ne propose plus qu’un discours appauvri : taxer les riches, dénoncer le racisme à tout propos.
Le niveau intellectuel s’est effondré, les revues ont disparu, la réflexion s’est asséchée. C’est dramatique.
S.C. : Vous portez un regard sévère sur La France insoumise.
G.B. : Ce mouvement s’est transformé. Ce n’est plus un parti républicain de gauche, mais une machine électorale.
Le cœur militant n’est pas composé de jeunes des banlieues, mais de petits Blancs diplômés déclassés, très vindicatifs, qui s’approprient tous les sujets avec hystérie.
La direction a choisi de transformer les métropoles et les banlieues en bastions électoraux, au prix d’une démagogie totale.
S.C. : Vous analysez également la progression de Giorgia Meloni en Italie.
G.B. : Meloni s’inscrit dans la continuité du MSI. Elle a transformé ce courant post-fasciste en mouvement national-conservateur.
Elle a su capitaliser sur la chute de Berlusconi et la faiblesse de Salvini.
Son succès s’explique par une véritable culture politique, transmise dans les familles italiennes, et par une formation intellectuelle solide de ses cadres. Elle a aussi su rassurer le pays, ce qui explique la stabilité de sa position.
S.C. : Vous regrettez la disparition de ce que Gramsci appelait « l’intellectuel organique ». Peut-on encore espérer son retour ?
G.B. : L’intellectuel organique suppose une classe ascendante. Aujourd’hui, toutes les classes sont descendantes, même les plus riches.
La figure de l’intellectuel est malmenée. On la remplace par celle de l’influenceur.
Il n’y a plus de continuité du débat, plus de temps long. La politique est devenue une succession de propositions gadgets. L’intellectuel n’a plus de prise sur le réel.
S.C. : Face à ce constat, que faire ? La Ve République est-elle condamnée ?
G.B. : Le régime est mourant, oui. Mais on ne peut pas attendre son effondrement sans rien faire.
Je crois à la reconstruction locale : la paroisse, le syndicat, l’école, la mairie, le club de foot, toutes ces structures qui recréent du lien humain.
Il faut retisser du tissu social, réhabiliter la présence humaine, redonner du sens à l’engagement concret.
Et surtout, il faut remettre le numérique à sa place : un outil, pas une religion.
Écrit par: R2LH
editions du cerf Gaël Brustier Gramsci La route vers la dévilisation Norbert Elias
Articles similaires
Articles récents
- Sécurité et fiscalité: un sondage de l’équipe Brot fait réagir la majorité municipale de Ramonville
- “Nous dansons sur un volcan” – Gaël Brustier décrypte la décivilisation
- Interview de Gaël Brustier – « La route vers la décivilisation » (Éditions du Cerf)
- Les Médiévales de Baziège 2025 : trois jours entre histoire, savoir-faire et convivialité
- Castanet-Tolosan : des ombrières photovoltaïques pour une énergie plus durable
Commentaires récents
Aucun commentaire à afficher.Chart
Top popular

Ramonville : Sylvie Brot dénonce l’affichage du drapeau palestinien sur la mairie

Castanet-Tolosan, Ramonville Saint-Agne et Saint-Jory champions des impôts locaux

Enlèvement à Castanet : trois jeunes interpellés après une agression sous la menace d’un couteau

Municipales 2026 à Ramonville : Lubac, Brot et la liste écologiste, trois visions pour l’avenir de la commune

La plateforme logistique de LIDL à Baziège ne respecte toujours pas les normes.
Copyright Pro Radio - Edit this text in customizer.




Commentaires d’articles (0)